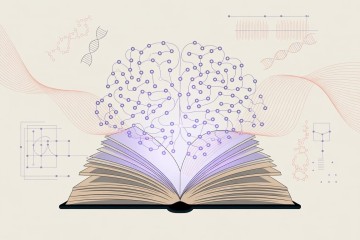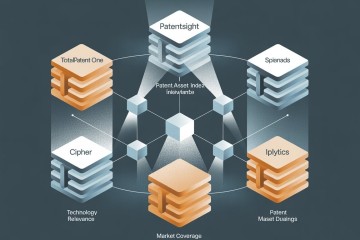Quand les professionnels de l’information doivent réinventer leur métier à l’aune de l’intelligence artificielle
Nous avons convié Mathieu Andro à nous partager son parcours et ses perspectives sur l’intégration de l’intelligence artificielle générative dans les pratiques professionnelles, en particulier dans le domaine de la veille informationnelle.
Mathieu Andro est titulaire d’un doctorat en sciences de l’information et de la communication, obtenu à Paris 8 en 2016 avec une thèse portant sur le crowdsourcing. Il a assuré pendant cinq années l’animation du réseau de veille auprès des services du Premier ministre. Depuis septembre 2025, il exerce la fonction de chef du bureau de la politique documentaire au sein des ministères sociaux, regroupant le ministère du Travail, le ministère de la Santé et le ministère des Solidarités.
Auparavant, il a travaillé pour les bibliothèques du Muséum national d’Histoire naturelle, dirigé celle de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse, conduit les projets de numérisation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, puis développé des services de text mining à l’Institut National de la Recherche Agronomique avant de devenir chef d’une division spécialisée dans la veille à la Cour des comptes.
Il est l’auteur de plus de 50 publications sur les bibliothèques numériques, le crowdsourcing, le text mining, la veille et l’open access.
CHRISTEL RONSIN : Mathieu, depuis quand utilisez-vous l’intelligence artificielle générative dans votre métier ?
MATHIEU ANDRO : Avant de parler de l’« IA générative », si l’on inclut des technologies comme l’OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) ou la structuration de corpus à partir de langage naturel, alors j’en utilise depuis mes premières expériences de numérisation à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Pour moi, la constitution de corpus numériques a constitué une première étape vers l’IA générative, en préparant le terrain à des traitements automatisés du langage.
La deuxième étape de mon parcours, c’est mon travail à l’INRA, dans le domaine du text mining. J’y structurais de vastes corpus textuels pour produire des cartographies sémantiques, ce qui revient à extraire des modèles de sens à partir du langage naturel. Aujourd’hui, avec les grands modèles de langage, on fait l’inverse : on part du modèle pour produire du texte. Il y a donc une continuité conceptuelle entre ces deux démarches.
Autrement dit, j’ai vu venir cette évolution. À l’époque, nous imaginions déjà la possibilité qu’un jour, des modèles de langage puissent simuler non seulement un style, mais aussi une pensée, voire une manière de philosopher ! C’est pour cela que je me suis lancé sans hésiter dès l’arrivée de ChatGPT : j’y ai vu une concrétisation de ce que j’avais entrevu depuis longtemps.
CR : Par la suite, au sein du réseau de veilleurs des services du Premier Ministre, comment avez-vous utilisé l’intelligence artificielle générative ?
MA : Dès que les outils ont été accessibles, nous les avons expérimentés dans le cadre du réseau. Le premier usage fut la production de résumés et de synthèses automatiques, à partir des corpus de veille. Cela prolongeait nos pratiques antérieures en text mining : extraction d’entités nommées, analyses d’occurrences et de co-occurrences.